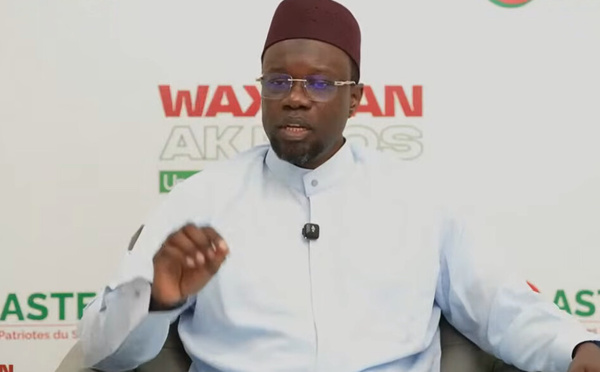A en croire la mythologie que lui-même avait façonnée et entretenue autour de son personnage, il était Le Dernier des Bevilacqua, fonçant à bord d’un « coupé façon Pininfarina » (le designer de Ferrari) entre les Vespa dans les faubourgs de Rome. Et dans un « complet droit », élément d’un vestiaire qui comprend encore une « veste de soie rose » (Les Paradis perdus) ou un « smoking blanc cassé » (La Dolce Vita). Ainsi se présentait Christophe en 1974 dans l’ouverture grandiose, sur fond de piano romantique et de nappes de synthétiseurs, de l’album Les Mots bleus, une de ses plus belles réussites, avec la complicité d’un parolier alors inconnu du nom de Jean-Michel Jarre.
Le chanteur Christophe, que Daniel Bevilacqua – son vrai nom – évoquait à la troisième personne du singulier, est mort, jeudi 16 avril, des suites « d’un emphysème », maladie pulmonaire, a indiqué à l’Agence France-Presse Véronique Bevilacqua, son épouse, dans la nuit de jeudi à vendredi. L’artiste avait été hospitalisé et admis en réanimation le 26 mars dans un hôpital parisien, avant d’être transféré à Brest. « Christophe est parti. Malgré le dévouement sans faille des équipes soignantes, ses forces l’ont abandonné », écrivent dans un communiqué son épouse et sa fille Lucie. Il était âgé de 74 ans.
Son parcours dans le paysage d’une chanson française qu’il aura mâtinée d’italianité et de rock primitif est tout à fait unique : propulsé vedette yé-yé en 1965, alors qu’il n’avait pas encore 20 ans, grâce à un slow larmoyant répondant au doux prénom d’Aline, Christophe aura survécu à deux éclipses pour se réinventer en marginal dont la cote n’a cessé de croître à mesure que s’éloignaient les succès commerciaux. Le chanteur de bluettes se métamorphosa en explorateur sonore, oiseau de nuit haut perché et penché sur ses piscines de champagne.
La jeunesse de Daniel Bevilacqua, né le 13 octobre 1945 à Juvisy-sur-Orge (alors Seine-et-Oise, aujourd’hui Essonne), est caractéristique de ces baby-boomeurs enfants du rock. Héritier d’une famille originaire du Frioul, ce fils d’un chauffagiste et d’une couturière s’évade, comme les rebelles fréquentant le Golf-Drouot (Johnny, Eddy, Jacques et les autres), dans les rêves que procure l’American way of life, westerns et cigarettes blondes, drague et chewing-gums, rock’n’roll. Ses héros sont salués dans la coda des Paradis perdus, dont Christine & the Queens, d’une autre génération, n’a pas tenu compte dans sa reprise en 2014 : débarrassé de sa veste de soie rose et de son humeur morose, Christophe se barde de cuir et s’éraille sur les onomatopées de Little Richard et Gene Vincent.
Sommet du hit-parade
Cet amoureux du blues fait ses gammes au début des années 1960 en tant que vocaliste de Danny Baby et les Hooligans. En préférant aux adaptations en français de standards rock, lot de l’école « Salut les copains », le « yaourt », ce faux anglais qui sacrifie le sens à la sonorité et qu’il n’hésitera pas à graver dans le single Voix sans issue, en 1984. Puis le blondinet débutant publie, en 1964, Reviens Sophie, un blues électrique qui passe inaperçu.
A l’inverse, à l’été 1965, de sa deuxième tentative, un slow de plage sur la mort d’un amour que l’arrangeur Jacques Denjean dramatise de chœurs féminins et de cordes lacrymales. Numéro un en France (mais pas seulement) avec un demi-million d’exemplaires écoulés, Aline entre en concurrence frontale avec Capri, c’est fini qu’Hervé Vilard a proposé peu auparavant sur le même sujet, également avec le renfort de Denjean. Un long procès pour plagiat suivra avec un rival malheureux, Jacky Moulière, dont La Romance de 1963 est effectivement très proche, sachant que les progressions d’accords des slows de l’époque ne brillent pas par leur originalité. Christophe gagnera en appel en 1977 et en profitera deux ans plus tard pour relancer son tube sur le marché en trônant à nouveau au sommet du hit-parade.
La nouvelle idole des jeunes confirme avec Les Marionnettes, son deuxième numéro un, avant que la voix colérique et les violons nerveux d’Excusez-moi, monsieur le Professeur, en 1966, n’indiquent déjà un changement d’attitude. « Si je me tiens debout/Tout au fond de la classe/C’est parce que je n’aime pas/Faire les choses à moitié », s’emporte-t-il. Cette même année, il pose, au côté de Richard Anthony, sur la fameuse « photo du siècle » rassemblant les « Copains » prise par Jean-Marie Périer. Lui, pourtant, ne sera pas un yé-yé de plus, de ceux qui rallieront quatre décennies plus tard la tournée de vedettes déchues « Age tendre et tête de bois ».
Au moment où la jeunesse française commence à préférer les originaux anglo-saxons aux piètres copies françaises, il profite de sa soudaine notoriété pour s’offrir les bolides de ses rêves, flamber en fantasmant sur le destin de James Dean (vivre vite, mourir jeune) et prendre la tangente. Son étoile pâlit, de reprises en italien de ses récents succès en 45-tours vite oubliés. Dans J’ai entendu la mer, il revient sur les lieux du crime d’Aline : « Châteaux de sable sont écroulés/La plage est sale d’amours fanées ».
De nouveaux horizons
Son départ de Disc’AZ, le label de Lucien Morisse, directeur des programmes d’Europe 1, pour Disques Motors, l’enseigne fraîchement créée par Francis Dreyfus, va lui ouvrir de nouveaux horizons. D’abord avec la bande originale de La Route de Salina (1970), film de Georges Lautner, qui lui permet d’assouvir ses envies psychédéliques et néobaroques. Les 45-tours qu’il enregistre alors affichent des ambitions inédites. Ainsi des Jours où rien ne va (1973), étincelante face B avec harpe, cordes et cuivres panoramiques, qui préfigure son retour au premier plan. L’association avec Jean-Michel Jarre et le claviériste Dominique Perrier, concrétisée par le diptyque Les Paradis Perdus/Les Mots Bleus, l’impose comme maître français de la romance à l’italienne, néanmoins capable de basculer dans le rock lourd (Mama). Christophe triomphe à l’automne 1974 lors de deux soirées à l’Olympia parisien – immortalisées par son premier album live. Habillé par Cerruti, il s’accompagne sur un piano blanc à queue qui s’élève de la scène jusqu’à l’apothéose de Drôle de vie.
Il a réapparu tel qu’il sera désormais figé : cheveux longs, moustache gauloise, voix androgyne. Macho et féminin, dandy et beauf, sophistiqué et naïf, précieux et maladroit. Un incurable romantique trimballant son spleen dans des palais aussi condamnés que ses amours, que l’on range dans la catégorie des reclus qui se tiennent à l’écart des modes, Nino Ferrer, l’autre rital tourmenté de nos contrées, ou Gérard Manset.
Il cultive le « Beau bizarre », un concept baudelairien, baptisant ainsi, en 1978, l’album qui lui vaudra les faveurs de la critique rock
Appelé à une renommée planétaire, le parolier Jarre passe le relais à Boris Bergman, le futur complice d’Alain Bashung, pour Samouraï (1976), disque kamikaze, éloigné des structures conventionnelles de la chanson, qui n’empêche pas Christophe de revenir aux ballades doucereuses sur 45-tours (La Dolce Vita, Daisy). Il cultive le « Beau bizarre », un concept baudelairien, baptisant ainsi, en 1978, l’album qui lui vaudra les faveurs de la critique rock. Avec un nouveau parolier, Bob Decout, il donne le pouvoir à l’électricité, basse et guitares, riffs et soli pour se glisser dans un univers interlope peuplé de marlous, strip-teaseuses et « actrices pour films danois ». Aussi inquiétant que Le Grand Couteau, monument du disque. La chanson Le Beau bizarre met en scène son nouvel avatar : « Si j’ai ma veste noire/Ce n’est pas par hasard/C’est la couleur que je préfère/Le blanc, c’était hier. »
Reconverti bad boy (ou cattivo ragazzo), Christophe préfère dorénavant la compagnie des bars à flippers à la solitude des loggias. Il persiste en 1980 avec Pas vu pas pris, en collaborant avec son scandaleux beau-frère punk, Alain Kan. Avec trivialité, quand, dans Méchamment rock’n’roll, il s’imagine amant d’une « poupée série-noire au valseur alléchant ». Pour s’extraire de l’impasse, Clichés d’amour (1983) lui offre un rôle de crooner de jazz devant un orchestre de grand hôtel, pour des adaptations en français de standards signées Philippe Paringaux, journaliste du magazine Rock & Folk. Besame Mucho devient Dernier baiser et Cry me a River, Noir est ta couleur.
Entre kitsch et branché
Ces revirements aboutissent à une rechute qui a l’avantage de réveiller l’intérêt des programmateurs radio, au risque de menacer sa crédibilité artistique. Succès fou, titre prémonitoire de sa fortune commerciale, le renvoie, toujours en 1983, à la case départ en l’apparentant davantage à C. Jérôme qu’à son idole Alan Vega, le chanteur électrocuté de Suicide. Ce retour au slow d’antan, plombé par les vilaines orchestrations synthétiques des années 1980, est confirmé par les singles suivants, J’l’ai pas touchée, Ne raccroche pas (une adresse à une princesse Stéphanie qui s’apprête à faire souffler un ouragan), puis Chiqué chiqué (1988), prélude à huit années de silence. Son crédit ne s’améliore pas quand on apprend qu’il est l’auteur de la musique de Boule de flipper, de Corynne Charby.
Mais, dans la musique populaire, la frontière entre le kitsch et le branché est particulièrement poreuse. Nul ne l’aura mieux illustré que l’ancien minet du Drugstore quand il revient en 1996, désormais sous contrat avec Epic, une filiale de Sony. Bevilacqua, qui passera sous les radars, est un déroutant album d’ambiances électroniques, drum’n’bass et jungle, comprenant un hymne à Ferrari (Enzo) ou une partie de poker avec Alan Vega (Rencontre à l’as Vega). Auteur des textes, Christophe s’y affirme comme un songwriter complet. Admirateurs fidèles, le journal Libération et Alain Bashung, qui s’est approprié Les Mots bleus avec superbe en 1992, encensent un génie incompris. Ce sera bientôt la doxa s’agissant de Christophe.
Plus abordable, Comme si la Terre penchait (2001) offre au revenant une exposition médiatique qui met invariablement en valeur une personnalité excentrique et hors du temps, un fétichiste collectionneur de juke-box et de pin-up, donnant des recettes de cocktails et pestant contre le permis à points. Un perfectionniste dont les créations balancent entre fulgurances (La Man, Ces petits luxes, L’enfer commence avec L) et inachèvement. Après plus d’un demi-siècle d’absence des scènes, le revoilà à l’Olympia, juché sur un tabouret, avec une chorégraphie confiée à Marie-Pierre Pietragalla. Le Tout-Paris se presse devant sa loge.
Réalisé par le guitariste Christophe Van Huffel (du groupe Tanger), Aimer ce que nous sommes (2008) justifie pleinement les éloges autour d’un casting disparate mêlant Isabelle Adjani, le trompettiste Erik Truffaz ou Carmine Appice, le batteur américain des groupes Vanilla Fudge et Cactus. Mal Comme et Parle-lui de moi sont de fait des chansons inouïes, surgies d’on ne sait où. La scène, qu’il a si longtemps boudée, devient son jardin. Il donne des concerts-fleuves (dont un, événementiel, le 15 juillet 2009 au bassin de Neptune du château de Versailles) qu’il prolonge par un tour de chant solo, en saluant au passage un autre moustachu célèbre de la chanson, Georges Brassens (La Non-demande en mariage).
Un volume d’inédits des années Dreyfus, Paradis retrouvé (2013), avait précédé son ultime album de chansons originales, Les Vestiges du chaos (2016), synthèse de sa sinueuse trajectoire et de ses obsessions, entre nocturnes à la chandelle et embardées électro-rock. Entre un hommage à Lou Reed et un nouveau duo avec Alan Vega – qui devait mourir trois mois plus tard –, on y retrouvait Jean-Michel Jarre pour la chanson titre et Boris Bergman. Avec réticence, Christophe avait sacrifié en 2019 à la mode des duos (avec Camille, Etienne Daho, Eddy Mitchell, Pascal Obsipo ou Jeanne Added) pour Christophe etc., deux volumes devenus prétextes à des jeux de collages autour des temps forts de son répertoire. En laissant à Philippe Katerine le soin de s’occuper d’Aline, il avait prouvé qu’il ne manquait ni d’humour ni d’esprit de sacrilège. Car, contrairement à d’autres, Christophe n’avait jamais renié son succès fou de jeunesse.